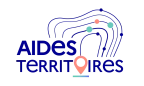Attention ! Cette aide n’est plus disponible.
Cette page restera accessible pour archivage.
PORTEUR D'AIDE PRIVÉ / AIDE PAYANTE
Accompagner les territoires ruraux dans l’élaboration de projets en lien avec la transition écologique
Nom initial de l’aide
« Des résidences pour la résilience »
Description
- Pourquoi faire des résidences ?
Aujourd’hui, des tensions s’observent dans les territoires ruraux autour de sujets clivants : déploiement des énergies renouvelables, accueil de nouvelles populations, transformation des pratiques agricoles… On trouve derrière ces sujets des enjeux de société majeurs : la transition énergétique peut-elle bénéficier aux territoires tout en préservant les paysages et le vivant ? Comment accueillir de nouvelles personnes sur des territoires habitables en limitant l’artificialisation des sols ? Comment développer une agriculture respectueuse de l’environnement et de la santé tout en garantissant des revenus dignes aux producteur·rices ? Finalement : comment réaliser une transformation écologique juste socialement et territorialement ?
Par ailleurs, on observe l’expression croissante dans certains territoires ruraux, notamment périphériques, d’un sentiment d’injustice et de délaissement lié au recul des services et à la dévitalisation. Cette impression d’abandon renforce la fracture existante entre une partie de la population qui appartient à la ville, et une autre qui appartient à la campagne. Ce sentiment d’appartenance peut nourrir des représentations collectives incarnées par une identité rurale forte, autour de notions comme l’authenticité ou l’autonomie. Ces représentations sont réappropriées par des forces politiques qui nourrissent et instrumentalisent ce sentiment identitaire pour favoriser le repli sur soi.
Il s’agit aujourd’hui d’inventer des récits alternatifs qui permettent aux ruralités de s’appuyer sur des identités plurielles pour renforcer leur pouvoir d’agir. Nous proposons d’accompagner la mise en mouvement des campagnes en tenant compte des initiatives locales et des forces en présence, et en abordant sereinement les grands enjeux territoriaux au sein d’espaces d’intelligence collective. Nous travaillons ainsi dans l’optique de construire des dynamiques favorables à l’émergence de projets multiples, qui permettent aux campagnes de se réinventer sans tomber dans les pièges du repli.
Ces résidences visent donc à accompagner tout type d’acteur territorial qui souhaite développer une réflexion autour d’un enjeu majeur de son territoire, dans une perspective de développement local et de coopération.
- Les résidences en un coup d’œil
Sur chaque territoire accompagné, les résidences ont pour objectifs de :
• Faire émerger des alternatives
• Impulser des dynamiques de coopération et créer de l’engagement collectif
• Créer de l’attachement au territoire
• Diffuser la culture de la transition
Les résidences de la Traverse durent un an et se déroulent en trois phases :
1. Portrait de territoire : Enquête sensible pour mettre en récit le territoire (son histoire, ses spécificités, ses marqueurs culturels et ses enjeux) et donner voix aux personnes qui l’habitent et le font vivre.
Restitution de l’enquête par la production d’un podcast.
2. Mise en mouvement : Temps de formation sur les enjeux écologiques et sociaux et sur la thématique de travail choisie pour la résidence ; structuration d’un groupe d’appui local pour accompagner la démarche ; élaboration des premières pistes d’action.
Organisation d’un “voyage apprenant” auprès d’un territoire inspirant.
3. Action : consolidation du plan d’action ; amorçage des projets ; accompagnement et outillage de groupes porteurs de projets.
Dispositif d’accompagnement “Premiers pas”.
Cet appel à territoires est adressé en priorité aux territoires ruraux du centre-ouest de la France hexagonale. Peuvent y répondre aussi bien des collectivités territoriales que des acteurs locaux (associations, entreprises, collectifs informels, groupes d’habitant·es…) tant que l’équipe répondant à l’appel est constituée d’au moins un.e élu.e, un.e habitant.e et un acteur local.
- Calendrier :
• Clôture de l’appel à territoires : 1er octobre.
• Lancement des résidences : début 2025
• Fin des résidences : début 2026
- Notre expérience des résidences
Une première salve de résidences a été effectuée sur 3 territoires du Poitou : la commune de Migné-Auxances (démarche « Page Blanche à Migné-Auxances), la commune de Jazeneuil (démarche « quel avenir pour Jazeneuil ? »), et un groupement de communes dans le Mellois-en-Poitou (démarche « COMET – Communes melloises en transition »).
Ces premières résidences se clôturent définitivement cet été 2024, après une année de résidence active en 2021-2022 et un suivi régulier depuis l’année 2023. Elles ont contribué à engager ces territoires dans de nouvelles dynamiques, avec des actions menées sur des thématiques variées (voir encadré ci-dessous).
Elles ont permis de construire de nouveaux espaces d’implication citoyenne et de coopération entre différentes catégories d’acteurs. Elles ont généré de la fierté et consolidé l’engagement de nouvelles personnes, soucieuses de leur territoire et désireuses de contribuer à le faire vivre. Elles ont aidé à construire des trajectoires de transformation cohérentes avec l’identité et le potentiel spécifiques de chacun des territoires. Elles ont initié la création de nouveaux espaces de dialogue entre acteurs, mais aussi entre collectivités, et ont ainsi contribué à renforcer les coopérations inter-territoriales.
L’inscription de cette démarche dans le temps long a permis à notre équipe de tirer les leçons de cette première mouture. Au moyen d’un long travail d’auto-évaluation et de capitalisation, nous avons pu mesurer l’impact de notre action, ses effets utiles, ses réussites, mais aussi ses angles morts et ses fragilités. Ce travail nous a permis de dégager des perspectives concrètes pour proposer de nouvelles résidences plus efficaces et plus impactantes. Au bout du compte, l’équipe est parvenue à produire une nouvelle version de résidence, dont les objectifs et la méthode sont détaillés dans cet appel.
- Témoignage de Florence Jardin, Maire de Migné-Auxances et Présidente du Grand Poitiers
« Résidences : connaissances et interconnaissance au service de la transition »
«Nous avions l’idée, la volonté et le projet : « une transition écologique volontariste pour tous et par tous ». Il nous manquait l’outil, la méthode, les références.
La proposition de « résidence » de l’équipe de La Traverse nous a séduits en écho à l’accueil d’artistes que nous pratiquions déjà tout en bouleversant totalement notre approche pour faciliter l’implication citoyenne.
Initier une telle démarche en tant que commune n’est pas simple. Les repères des élues/élus, des fonctionnaires et des habitantes/habitants sont effacés au profit de la découverte, de la prise de connaissances, de l’expérimentation. La Fabrique* est née dans ce contexte avec l’objectif de s’inspirer des séquences démocratiques de Kingersheim. Au fil du temps, le groupe s’est, semble-t-il, stabilisé et le concept a évolué vers un projet local, adapté aux personnes et aux moyens. Si la dynamique a créé des envies, le tâtonnement a généré des déceptions. Mais la création collective est à ce prix. Et nous avons créé, porté des projets : plantation pour une ville comestible, pédagogie et réflexion autour du bilan carbone de la restauration scolaire, commande groupée de récupérateurs d’eau et animation d’une « Fabrique à projets » qui elle-même a permis rencontres, partage d’idées et naissance de nouveaux projets… Migné-Auxances est bel et bien une commune en transition »
* La Fabrique est le nom que s’est donné le groupe d’appui de Migné-Auxances.
- Les objectifs de la résidence
Faire émerger et se développer les alternatives qui contribuent à la métamorphose des territoires
◦ Faire grandir ou structurer les alternatives qui existent et qui en ont besoin
◦ Faire émerger de nouvelles alternatives
◦ Permettre de meilleurs arbitrages et des renoncements démocratiques pour répondre aux besoins des habitant·es et du territoire
Impulser des dynamiques de coopération et créer de l’engagement collectif
◦ Créer de nouveaux espaces de coopération et consolider l’engagement des personnes
◦ Permettre le déploiement de projets co-portés par différentes catégories d’acteurs (élu·es, habitant·es, acteurs socio-économiques)
◦ Renforcer le lien social et le pouvoir d’agir des habitant·es et de la société civile
◦ Renforcer la qualité du dialogue (y compris sur des sujets de tension) et améliorer la prise en compte des besoins de tous les publics
Créer de l’attachement au territoire
◦ Révéler les marqueurs d’identités territoriales (culturels, historiques, géographiques, sociaux, économiques, savoir-faire)
◦ Générer de la fierté à habiter le territoire et à faire ensemble
◦ Construire une vision collective de l’avenir du territoire
Diffuser la culture de la transition
◦ Former les élu·es, acteurs et habitant·es aux enjeux écologiques
◦ Développer une vision politique de l’écologie (collective, organisationnelle)
De quelles alternatives parle-t-on ?
Les alternatives « qui contribuent à la métamorphose des territoires » sont les initiatives qui s’inscrivent en faux avec une trop grande interdépendance des territoires avec des systèmes mondialisés (les rendant vulnérables aux crises planétaires), et qui renforcent la capacité des territoires à répondre aux besoins de leurs habitant·es sans dégrader a santé des personnes et du vivant, et sans dépendre des circuits complexes et fragiles de la mondialisation. Elles participent à la transformation écologique juste des territoires.
Il peut ainsi s’agir d’alternatives dans les manières de produire (agro-écologie, agriculture paysanne, artisanat, autoproduction culturelle…), de distribuer (circuits courts, réciprocité des relations consommateur-producteur…), de consommer (produits bruts, vrac, réemploi…), d'informer (médias indépendants locaux, cafés-librairies…), de rendre service (systèmes d’échanges locaux, services collectifs…), d’habiter (habitat collectif, léger, financement citoyen et solidaire…), d’aménager le territoire (« ménagement du territoire », renaturation, renoncement à certains projets), ou encore d’appréhender les ressources (gestion par les communs, partage de la valeur…)
Elles peuvent également relever du champ de l’économie sociale et solidaire (ESS), si leur objet est d’utilité sociale, leur ancrage territorial et leur profit limité. Elles explorent de nouveaux modèles économiques et juridiques qui leur permettent de mettre en place des formes de gouvernance plus coopératives et horizontales. Les porteur·euses de ces alternatives insistent volontiers sur la recherche explicite d’un sens à leur action. Pour beaucoup, ce sens passe par le lien social et la recherche d’autonomie.
- Ce qu’on ne fera pas
Nos résidences ne sont pas conçues pour travailler sur l’acceptabilité sociale de projets donnés, ni pour construire des instances de consultation destinées à faire valider des projets, plans, et autres dispositifs déjà ficelés.
Même si nous travaillons à révéler des marqueurs communs pour mobiliser et engager le plus largement possible, notre équipe ne mettra ni les conflits ni les divergences d’intérêt sous le tapis. L’effort de mise en récits n’est pas destiné à produire une narration consensuelle, descendante et dépolitisée - mais bien à ouvrir l'espace de débat pour discuter autant de ce qui renforce les liens que de ce qui les défait.
Les résidences ne sont pas non plus pensées pour faire table rase du passé. Nous partirons de l’existant : le bon, mais aussi le mauvais. Nous tenterons ainsi de comprendre les réussites et les échecs des projets (passés et en cours) pour en tirer des enseignements et renforcer la capacité du territoire à ne pas reproduire d’éventuelles erreurs et à savoir renoncer à certains projets ou certaines pratiques. À cet égard, se mettre d’accord collectivement sur ce qu’on ne veut pas est aussi une façon d’identifier ce qui nous réunit.
Enfin, notre rôle en résidence n’est ni de faire de l’animation territoriale, ni de sonder la population sur son opinion du mandat en cours, ni de réaliser un diagnostic technique sur les enjeux de transition ou de résilience.
- Des résidences thématiques
Pour cette deuxième version des résidences, nous proposons de nous concentrer sur un sujet donné. Ces résidences « thématiques » viendront ainsi appuyer des dynamiques spécifiques, sur des enjeux déjà identifiés par la collectivité et/ou par les acteurs.
Voilà quelques exemples de sujets qui pourront venir structurer nos résidences :
• Comment concilier arrivée des nouveaux habitants et objectifs "Zéro Artificialisation Net" ?
• Comment concilier juste rémunération des producteurs et accessibilité économique de l'alimentation ?
• Comment mettre à profit les "zones d'accélération des énergies renouvelables" pour renforcer l'autonomie énergétique des communes ?
De nombreuses thématiques sont possibles : redynamisation des centres bourgs ; gestion des communs sur le territoire (sols ; eau ; air) ; énergies renouvelables ; alimentation ; biodiversité ; mobilité ; enjeux paysagers ; santé environnementale ; adaptation au changement climatique ; renoncement à des projets néfastes pour l'environnement.
- Qui peut répondre à cet appel ?
Les résidences s’adressent à des territoires ruraux. Les secteurs situés dans le centre-ouest de la France hexagonale, et tout particulièrement dans le Poitou et ses départements limitrophes, seront privilégiés.
Nous concevons les « territoires » comme des écosystèmes d’acteurs agissant à l’échelle locale. Autrement dit, non seulement les collectivités locales peuvent répondre à cet appel (communes, intercommunalités, PETR, PNR, PTCE…), mais aussi chacun des acteurs fortement impliqués localement (associations, entreprises, collectifs informels, groupes d’habitant·es…).
Quelle que soit l’organisation qui porte la réponse à cet appel (collectivité ou acteur), chaque candidature devra être menée en équipe territoriale. Cette équipe devra être composée d’au moins 3 personnes (une personne par catégorie d’acteurs) : un·e élu·e, un acteur local et un·e habitant·e. Elle constituera le « groupe d’appui » tout au long de la démarche.
- Description des résidences
Une résidence, c’est quoi ?
Une résidence consiste en des temps longs d’immersion sur les territoires. La méthode proposée ici se déroule en une année et propose une quinzaine de jours de présence sur le territoire, dont une résidence de 6 jours consécutifs, et des temps d’immersion les week-ends, lorsque les habitant·es sont disponibles. Dans la mesure du possible, nous essayons de mutualiser nos temps forts avec des événements locaux en nous rapprochant des initiatives locales. Lorsque nous sommes en résidence sur un territoire, nous demandons à être hébergé·es chez l’habitant·e afin de nous ancrer réellement dans la vie locale. Faire nos courses, nous déplacer, manger, rencontrer les habitant·es dans des contextes informels… tout cela contribue à nous imprégner du territoire et de ses enjeux.
Plus précisément, une résidence se découpe en trois phases.
1 – Vérités… – le portrait de territoire
Nous commençons notre résidence par une phase d’enquête sensible qui doit nous permettre de mieux connaître le territoire et ses enjeux, d’identifier les acteurs relais à mobiliser, de récolter des données sur l’enjeu traité, mais aussi de commencer à mettre en récits la dynamique à l’œuvre sur le territoire.
Cette narration prend notamment la forme d’un podcast, visant à :
• valoriser l’histoire du territoire, ses initiatives, son dynamisme, son potentiel depuis différentes voix ;
• révéler l’attachement des habitant·es à leur territoire, renforcer la fierté à l’habiter ;
• révéler des marqueurs communs (culturels, historiques, géographiques, patrimoniaux, problématiques…) ;
• aborder en profondeur le ou les sujets prioritaires, définis avec le groupe d’appui.
Pour commencer, on sélectionne avec le territoire le ou les sujet(s) à traiter et les personnes pertinentes pour témoigner (élu·es, acteurs économiques, associatifs, habitant·es...). On va collecter les témoignages au travers d’entretiens individuels, au micro. Ces témoignages doivent éclairer l’histoire du territoire, ses spécificités, ses marqueurs culturels, ses principaux enjeux, et donner à voir les engagements de la collectivité et des acteurs locaux en matière de transition.
Avec toute cette matière, on propose un podcast sous forme de portrait de territoire. Un teaser est disponible à ce lien : https://latraverse.lepodcast.fr/teaser-decouvrez-le-podcast-des-residences-de-la-traverse
Dans le même temps, on travaille à la diffusion de ce portrait, en travail étroit avec le groupe d’appui. On mobilise nos différentes plateformes de diffusion et d’éventuelles radios locales partenaires. On embarque aussi la presse locale, et tous les acteurs relais pertinents.
2 – Chiche ? – la mise en mouvement
Cette deuxième phase vise à consolider le groupe d’appui, rechercher de l’inspiration, comprendre et sensibiliser, se projeter dans une vision collective, et initier des premières pistes d’action.
Elle passe notamment par un voyage apprenant, commun à l’ensemble des territoires de résidence, sur un territoire « inspirant ». Ce voyage permettra de voir ce qui fonctionne ailleurs, mais surtout de comprendre, sur un sujet donné, quels ont été les facteurs de réussite, ainsi que le processus et les étapes ayant conduit à sa meilleure prise en charge. La
Critères d’éligibilité
État d’avancement du projet pour bénéficier du dispositif : Réflexion / conception,
Autres critères d’éligibilité :
- Qui peut répondre à cet appel ?
Les résidences s’adressent à des territoires ruraux. Les secteurs situés dans le centre-ouest de la France hexagonale, et tout particulièrement dans le Poitou et ses départements limitrophes, seront privilégiés.
Nous concevons les « territoires » comme des écosystèmes d’acteurs agissant à l’échelle locale. Autrement dit, non seulement les collectivités locales peuvent répondre à cet appel (communes, intercommunalités, PETR, PNR, PTCE…), mais aussi chacun des acteurs fortement impliqués localement (associations, entreprises, collectifs informels, groupes d’habitant·es…).
Quelle que soit l’organisation qui porte la réponse à cet appel (collectivité ou acteur), chaque candidature devra être menée en équipe territoriale. Cette équipe devra être composée d’au moins 3 personnes (une personne par catégorie d’acteurs) : un·e élu·e, un acteur local et un·e habitant·e. Elle constituera le « groupe d’appui » tout au long de la démarche.
- Les engagements du territoire d’accueil
Pour candidater, les territoires doivent au préalable construire une équipe composée d’au moins un·e élu·e, un acteur local et un·e habitant·e, qui constituera le « groupe d’appui ».
Avant la résidence, ce groupe d’appui s’engage :
• à participer à la co-construction de la méthode de résidence, sur la base des propositions de La Traverse ;
• à participer à la recherche de co-financements ;
• à préciser le sujet et la problématique précise à traiter pendant la résidence.
Pendant la résidence, ce groupe d’appui s’engage :
• à faciliter l’hébergement des membres de La Traverse pour les temps d’immersion ;
• à contribuer activement au relais de la démarche et à la mobilisation ;
• à participer à l’organisation et au déroulé des temps collectifs (environ 5 temps)
• à proposer une liste de témoins pour nourrir le récit, et à mobiliser avec La Traverse ces témoins ;
• à participer à chacun des temps inter-territoires, notamment le voyage apprenant.
Après la résidence, ce groupe d’appui s’engage :
• à suivre et accompagner les projets en cours, voire à continuer d’animer la dynamique
• à faciliter l’évaluation du projet (entretien, questionnaire, échanges avec d’autres territoires) ;
• à témoigner de cette démarche au sein de leurs réseaux et auprès d’autres territoires.
- Le coût d’une résidence
Le coût d’une résidence peut varier selon la méthode précise retenue, ajustée en fonction des besoins de chaque territoire et construite avec lui. Dans tous les cas, ce budget est co-porté par La Traverse et les territoires, qui apportent un co-financement. Si nécessaire, La Traverse accompagne les territoires retenus dans la recherche de co-financements.
Plusieurs types de financements sont mobilisables :
• les financements thématiques (fondations, appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, Fonds Vert) ;
• les dispositifs spécifiques de l’État (Petites Villes de Demain, Action Coeur de Ville, Village d’Avenir) ;
• les fonds européens ;
• les crédits de formation (notamment pour la phase 2).
Avant ajustement méthodologique et sur la base de notre proposition « brute », le coût d’une résidence territoriale s’élève à environ 40.000€.
Exemples de projets réalisables :
Plusieurs actions ont été impulsées dans les territoires déjà accompagnés par les résidences :
- Prototypage de fours solaires pour utilisation par les habitant·es et par les associations de la commune
- Constitution d’un groupe de travail sur la végétalisation et la plantation de haies
- Réalisation de deux Bilans carbone © (un pour la restauration collective d’une commune, un pour une école élémentaire)
- Plantation d’arbres comestibles
- Création d’un groupe d’échanges de savoir-faire sur le jardinage
- Organisation de commandes groupées de récupérateurs d’eau par des habitant·es
- Création d’un marché fermier sur la commune
- Aménagement et valorisation des bords d’une rivière emblématique du territoire
- Pérennisation des collectifs d’habitant·es, d’élu·es et d’acteurs locaux qui continuent d’œuvrer pour impulser des projets de transition sur leur territoire